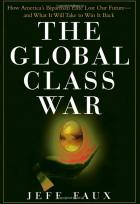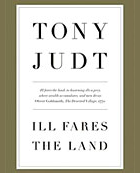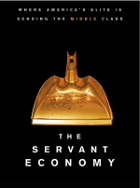Institutes |
Quels acteurs et quels niveaux pertinents de représentation
Sottotitolo:
L'observation des modes de gestion sociale des restructurations révèle un paradoxe .
L'observation des modes de gestion sociale des restructurations révèle un paradoxe . D'une part, on observe, depuis une vingtaine d'années, un développement du rôle accordé à l'entreprise dans la régulation de la relation d'emploi. Des lois Auroux (1982) jusqu'à la loi Fillon (2004), les institutions de représentation du personnel et la négociation collective d'entreprise ont vu leurs attributions ou leurs champs de compétence élargis. En ce qui concerne, en particulier, la mise en œuvre des restructurations, l'évolution de la jurisprudence puis de la législation ont renforcé les obligations, substantielles et procédurales, auxquelles sont soumises les entreprises . Enfin, le discours qui s'est développé sur la " responsabilité sociale " des entreprises, notamment au niveau des institutions européennes , a contribué à alimenter un mouvement qui élargit le rôle de l'entreprise dans la sphère de la régulation sociale. D'autre part, l'ensemble des recherches menées au cours de la même période par les économistes, les gestionnaires et les juristes ont mis en évidence l'indétermination croissante de la notion d'entreprise et, plus spécialement, des frontières de l'entreprise. Dès lors, on peut s'interroger sur la pertinence que revêt le niveau de l'entreprise pour définir des procédures de gestion des restructurations, pour organiser le débat et la négociation entre acteurs concernés, enfin, pour garantir les droits des salariés. Nous souhaitons ici nous interroger sur les choix stratégiques que peuvent opérer les organisations syndicales confrontées à ce problème. De manière schématique, face au diagnostic avéré de perte de pertinence de la notion d'entreprise, deux options sont ouvertes: - ou bien, chercher à reconstruire la notion d'entreprise parce qu'elle est jugée essentielle pour désigner le lieu central où peut être mise en question la responsabilité de l'employeur et donc, à l'arrière-plan, celle des décideurs économiques ; - ou bien, tirer les conséquences de la dilution de la notion d'entreprise et chercher à définir d'autres lieux et à créer d'autres acteurs pertinents pour la gestion des restructurations et la défense du droit à l'emploi. 1. Reconstruire la notion d'entreprise comme niveau pertinent de débat et de négociation sur les restructurations Il est usuel d'analyser, notamment à la suite d'Alain Supiot, l'évolution du contrat de travail, au cours de la phase qui va de l'essor de la grande industrie jusqu'aux années 1970, comme le produit d'un échange implicite : d'une part, le salarié accepte un lien de subordination, d'autre part, l'employeur garantit une sécurité ancrée dans la relation d'emploi. La validité générale de ce diagnostic rétrospectif mériterait d'être discutée, mais l'important est qu'il traduit bien les représentations du rapport salarial qu'adoptaient les acteurs sociaux dans les grandes organisations productives. Lorsque les restructurations industrielles y apparaissent, elles sont perçues par les salariés comme la rupture d'un engagement. C'est donc la responsabilité de l'entreprise employeur, celle du " patron ", qu'ils mettent en cause. Les acteurs compétents, les droits des salariés, les dispositifs de gestion des restructurations sont d'abord définis à ce niveau, même s'ils peuvent mobiliser des ressources créées au niveau de la branche ou de l'interprofessionnel. Une telle logique a pu se maintenir aussi longtemps qu'était approximativement vérifiée une hypothèse implicite sur la nature de l'entreprise. Un constat de disjonction croissante avec la réalité a suscité l'introduction de correctifs partiels dont on mesure aujourd'hui les insuffisances. La dilution de la notion d'entreprise, produit direct des nouvelles formes de mise en valeur des capitaux, crée un défi pour les stratégies syndicales : celui du choix du niveau pertinent de mobilisation des travailleurs et d'intervention dans la gestion. 11. Une hypothèse implicite Tra i fattori di successo imprenditoriale vi è, anche, il risanamento di imprese pubbliche (poste, ferrovie); la parziale privatizzazione delle imprese pubbliche nei settori strategici (energia, telecomunicazioni); l'accresciuta efficienza del sistema bancario, specie delle banche meridionali; la ricollocazione internazionale di fasi del processo produttivo in aree a basso costo del lavoro; il persistente successo delle produzioni italiane nella filiera dell'alta moda, e della meccanica strumentale. L'utilisation de la notion d'entreprise est commode pour poser et traiter les problèmes de restructurations si l'on accepte l'hypothèse d'une identité entre trois définitions possibles de l'entreprise, et donc trois modes de délimitation de ses frontières. - L'entreprise est une unité de production ou une organisation productive réunissant un ensemble interdépendant de moyens de production mis en œuvre par un collectif de travailleurs. Ce sont ces collectifs qui constituent les niveaux élémentaires de prise de conscience des solidarités et d'organisation des mobilisations. - L'entreprise est un employeur c'est-à-dire le point de jonction d'un faisceau de contrats de travail ayant d'un côté le même sujet juridique. C'est ce critère qui définit le champ de compétence des instances de représentation des travailleurs ou le champ d'application des accords d'entreprise. - L'entreprise est un centre de décision sur un capital. C'est à ce niveau que se prennent les décisions de restructuration. 12. Disjonctions croissantes et correctifs partiels Toute hypothèse est, par nature, simplificatrice ; telle est son utilité. Encore faut-il qu'elle mette en évidence des caractéristiques communes, majeures et dominantes, dans l'hétérogénéité des phénomènes observés. L'hypothèse d'identité des trois définitions de l'entreprise a pu constituer une approximation acceptable jusqu'aux lendemains de la Seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, elle semble radicalement invalidée par les transformations observables dans les systèmes productifs. Nous rappelons ici brièvement des phénomènes qui ont fait l'objet de multiples analyses. - Les disjonctions entre l'employeur et l'unité de production résultent de tous les mécanismes qui rendent possible l'existence d'une multiplicité d'employeurs au sein d'un collectif de travail concret (intérim, externalisation sur site, tours de bureaux…). Il n'existe pas pour l'ensemble des travailleurs présents dans l'unité de production un lien juridique avec un employeur unique, mais un lien d'appartenance a un groupe soumis à une seule organisation hiérarchisée et/ou placé dans le même environnement de travail. L'extension de la délimitation des salariés couverts par les CHSCT et la création de délégués de site illustrent des tentatives de prise en compte ponctuelle de ces désajustements. - Les disjonctions entre l'employeur et le centre de décision sur le capital sont devenues massives avec le développement des groupes d'entreprises et la complexification de leurs organigrammes. Dans ces cas, ce n'est en général que sur la base d'une fiction juridique qu'il est possible d'imputer à l'employeur la responsabilité des décisions qui sont à l'origine des restructurations. Ce dernier (en pratique, une filiale de énième rang) ne fait que prendre en charge, opérationnellement et juridiquement, les conséquences sociales d'une décision prise, selon des critères industriels ou financiers, à un niveau supérieur, souvent difficile à déterminer, de l'organigramme du groupe. Les salariés se trouvent en situation de dépendance économique à l'égard d'un centre de décision qui n'est pas leur employeur. Ici encore, des dispositifs ont été imaginés pour réduire les dysfonctionnements engendrés par la déconnexion entre l'employeur et le décideur. Les Comités d'entreprise européens et les Comités de groupe (en France) donnent, pour l'exercice d'un droit d'information et de consultation,á un cadre plus proche du niveau pertinent que celui des CE ou CCE . La loi Fillon a consolidé le statut juridique des accords de groupe ; ils peuvent inclure des accords de méthode sur la gestion des restructurations . La jurisprudence, enfin, a accordé une importance croissante à la notion de groupe pour apprécier le champ de référence des obligations de reclassement. Le problème n'est donc pas ignoré mais traité par des dispositifs partiels et disjoints. -Des phénomènes plus complexes doivent être pris en compte. Les réseaux hiérarchisés de sous-traitance engendrent une combinaison des deux phénomènes précédemment décrits, selon qu'il s'agit de sous-traitance interne sur un site productif du donneur d'ordre ou de sous-traitance externe. La dépendance économique se dilue tout au long de la chaîne de sous-traitance. Le cas des entreprises en réseaux, au sens strict du terme , accroît l'incertitude quant à l'imputation d'une responsabilité dans une opération de restructuration, alors que la nature même de ces réseaux rend le processus de restructuration potentiellement continu et les frontières du collectif de travail constamment mouvantes. À part quelques maigres avancées jurisprudentielles sur la prise en compte des relations de sous-traitance, ces nouvelles formes d'organisation restent pour l'essentiel un désert pour le droit du travail et la négociation collective. 13. Stratégies syndicales Si les stratégies syndicales, depuis la Seconde guerre mondiale, ont eu comme objectif principal de faire peser principalement sur l'employeur, en cas de restructuration, les obligations d'abord, de préservation de l'emploi et, en second lieu, de reclassement, les disjonctions dont nous avons fait l'inventaire ont mis en question la référence privilégiée à la notion d'employeur. Elle tend à devenir une fiction juridique qui masque les parties réellement en présence dans la relation d'emploi. Pour sortir de ce piège, deux options extrêmes peuvent être opposées, selon que le syndicat privilégie le niveau le plus efficace de mobilisation des travailleurs contre les restructurations ou le niveau le plus pertinent d'intervention dans les décisions de restructuration. 3. Per l'Italia, una politica economica deve avere come obiettivo, di breve periodo, la crescita del prodotto interno lordo, e, nel medio periodo, la crescita della produttività che consenta un aumento dei salari e quindi della domanda e dell'occupazione. Sulla stabilità dei prezzi vigilano la banca centrale europea e le banche centrali nazionali ma questa vigilanza rischia di trasformarsi in una politica di deflazione se non è accompagnata da accordi con le parti sociali basati sullo scambio politico fra maggiore occupazione e maggiori investimenti, contro stabilità dei prezzi e flessibilità nell'uso della forza lavoro, ossia crescita del costo del lavoro compatibile con la crescita della produttività. Nel breve periodo è indispensabile aumentare la domanda senza che comportamenti opportunistici da parte degli operatori, non soggetti alla concorrenza, possano creare le premesse per un aumento generalizzato dei prezzi e quindi provocare una riduzione dei salari reali che neutralizzerebbe l'aumento autonomo della domanda reale, ridurrebbe i profitti dei settori concorrenziali, e riprodurrebbe l'attuale situazione deflazionistica. (2)Lutter contre les conséquences des restructurations La lutte contre les restructurations, dès lors qu'elles mettent en danger, dans l'immédiat ou à terme, le niveau ou la qualité de l'emploi dans l'entreprise, constitue la réaction syndicale de base, qui peut s'intégrer à des conceptions fort différentes du syndicalisme. Par exemple, pour un certain type de syndicalisme " révolutionnaire ", c'est une occasion concrète d'affrontement avec une logique économique soumise au seul critère du taux de profit. Dans une vision du syndicalisme très éloignée de la précédente, il s'agit seulement de défendre les intérêts des travailleurs, sans que le syndicalisme ait à se mêler des décisions de gestion qui relèvent de la seule responsabilité de l'employeur. Les composantes d'une telle action s'échelonnent selon une hiérarchie logique et un déroulement chronologique : refuser les suppressions d'emploi ou, en tout cas, les licenciements ; minimiser le nombre des licenciements en assurant des reclassements internes ou, à défaut, externes sur des emplois convenables et durables ; en cas de licenciements, assurer les niveaux et les durées d'indemnisation les plus satisfaisants, associés si possible à des départs dits volontaires. L'efficacité d'une telle stratégie repose principalement sur le degré de mobilisation des travailleurs directement concernés. Le niveau et les acteurs de la représentation et de l'action seront donc situés au plus près des unités de production et des collectifs de travail touchés par les décisions de suppression d'emplois. C'est là seulement que peut naître une action unitaire, durable, parfois violente ; c'est à partir de là que se nouent des solidarités de proximité au niveau local. Enfin, on peut espérer amorcer une dynamique ascendante (bottom up) qui entraînera progressivement les salariés des autres composantes du groupe. L'expérience permet d'identifier la force et les limites de telles stratégies. La capacité de mobilisation locale est souvent élevée et durable. Elle peut engendrer des réactions de sympathie dans l'opinion publique ou des craintes quant à l'ordre public qui amènent les groupes, par souci de leur image ou pour répondre aux pressions qu'ils subissent, à accepter des concessions. Il est rare que la solidarité entre travailleurs au sein du groupe se manifeste autrement que par des gestes symboliques ou une aide financière. Généralement , les concessions finales se concentrent sur une amélioration, plus ou moins substantielle, des dispositifs de conversion et des indemnisations financières sans mettre en cause le principe de l'opération de restructuration, ni même, sauf à la marge, son ampleur. résultats en termes d'atténuation des coûts sociaux des restructurations, mais aussi comme menace crédible prise en compte par les groupes dans la définition de leurs choix. Il faut, en revanche, prendre acte des limites de leur impact économique. L'intervention dans les décisions de restructuration Le débat sur l'intervention des syndicats dans la gestion est presque aussi ancien que le mouvement syndical français et nous n'y reviendrons pas . Il a retrouvé une nouvelle vigueur au cours des années 1970 et au début des années 1980, notamment au sein de diverses Fédérations de la CFDT et de CGT ; il recoupait partiellement les discussions portant sur la forme de l'organisation syndicale à l'échelle des groupes industriels. Dans un contexte transformé, on retrouve aujourd'hui la même tension entre deux conceptions possibles de l'intervention dans les décisions de restructuration, ou plus largement dans la gestion des entreprises, pour les structures syndicales qui acceptent une telle démarche. L'objectif peut être principalement pédagogique. Il s'agit de dépasser une simple attitude négative de dénonciation des restructurations pour montrer la possibilité de solutions différentes fondées sur des critères différents de gestion micro et macroéconomique. C'est une forme concrète de mise en cause radicale de la domination des logiques de marché et de profit, qui n'implique aucune illusion sur la possibilité que les contre-propositions industrielles avancées puissent être acceptées dans le contexte présent. Il s'agit d'abord de convaincre les travailleurs de la possibilité et de la pertinence d'une alternative globale. Le travail d'explication et de conviction peut se mener à tous les niveaux sans nécessité d'arbitrages. La situation est différente lorsque la stratégie se donne des objectifs directement opérationnels. Ceci n'implique pas qu'elle ait à coup sûr des effets immédiats sur les opérations de restructuration engagées, mais qu'elle puisse avoir des effets identifiables, au moins à terme, sur les processus de prise de décision en matière de restructurations. Dans cette hypothèse, le niveau pertinent de représentation et d'action doit correspondre au centre de décision économique (l'état-major du groupe) et c'est là que l'acteur syndical doit se structurer et négocier. C'est aussi à cette échelle qu'il doit avoir l'expertise nécessaire pour construire des propositions alternatives et la capacité de mobiliser l'ensemble des forces syndicales du groupe pour créer le rapport de forces nécessaire à leur prise en compte. Une première solution peut être recherchée dans la transposition à l'échelle du groupe des institutions de représentation des salariés et des procédures de négociation collective qui ont fait la preuve de leur efficacité, à d'autres niveaux, pour gérer les conflits et définir des compromis entre le capital et le travail. Des structures syndicales et délégués syndicaux de groupe, des comités d'information et de consultation, des accords de groupe fournissent les outils d'intervention, au niveau pertinent, sur les logiques de restructuration. L'expérience fournit des enseignements quasi-symétriques quant à l'intérêt et aux limites de telles stratégies. La réunion, surtout à l'échelle internationale, des représentants syndicaux des différentes composantes du groupe, donne les moyens d'une capacité d'analyse et de proposition et crée une légitimité qui rend difficile pour les dirigeants du groupe un pur refus de la discussion. Le problème naît de l'extrême difficulté d'une mobilisation conjointe des collectifs de travail à cette échelle. Il est amplifié par le fait que les groupes manient parfaitement la mise en concurrence de leurs différentes unités de production à l'occasion des choix de créations, suppressions ou délocalisations d'activités. De manière sommaire, le constat est que le niveau d'intervention est le bon pour permettre la confrontation avec les " vrais décideurs ", mais qu'il est rarement opérant, au moins dans l'état actuel des prises de conscience, pour créer le rapport de forces qui permettrait de peser sur la décision . Une autre stratégie a été proposée et, dans une certaine mesure expérimentée. Elle ne s'appuie pas sur des instances et procédures classiques de confrontation des intérêts du travail et du capital, mais sur des mécanismes qui assurent une présence des travailleurs dans les lieux de gestion du capital ou une influence sur les prises de décision qui s'y opèrent. Nous ne pouvons que mentionner ici des orientations qui mériteraient une discussion approfondie. - Au terme d'une critique rigoureuse des " dérives du capitalisme financier ", Michel Aglietta et Antoine Rebérioux ont récemment remis à l'ordre du jour le projet d'ouverture des conseils d'administration aux représentants élus des salariés avec des droits équivalents à ceux des représentants des actionnaires. Ils s'appuient particulièrement sur l'expérience de l'Allemagne (Aglietta, Rebérioux, 2004). - Les mêmes auteurs reprennent aussi une proposition qui élargirait des expériences menées jusqu'ici à une échelle limitée par le mouvement syndical dans divers pays, notamment aux Etats-Unis, et qu'ils proposent de généraliser : l'utilisation de l'épargne salariale, notamment celle destinée aux retraites, pour financer des investissements échappant à la logique de la rentabilité privée. - Dans le même sens, on peut ranger les propositions qui visent à utiliser, sous la direction ou l'influence des syndicats, des procédures d'habilitation de fonds de placement ou de notation sociale des entreprises qui exerceraient une pression sur les modes de gestion des entreprises. Bien que les expériences disponibles dans ces domaines, menées à une échelle limitée et sous des contraintes sévères, n'aient pas donné de résultats notables , il est utile que le débat se poursuive sur de telles perspectives. Notons simplement qu'elles poseraient de façon encore plus aiguë que les précédentes la question des conditions de mobilisation des travailleurs. 2. Socialiser les garanties d'emploi dans les restructurations : acteurs, niveaux et mécanismes Un bref rappel historique est utile pour se libérer de la conception selon laquelle il serait évident que l'imposition à l'employeur d'obstacles à la rupture du contrat de travail constituerait toujours, pour les salariés, le moyen privilégié d'assurer la garantie de leur emploi. Jusqu'à la fin du XIX° siècle, les salariés ont, dans leur grande majorité, essayé d'échapper à une dépendance durable à l'égard d'un employeur unique. Ils ont utilisé différentes stratégies que les historiens ont bien décrites : organisation par les syndicats de métier de la mobilité professionnelle de leurs membres ; combinaison, simultanée ou alternante, d'activités salariées et indépendantes dans des branches d'activité différentes ; constitution de groupes de travailleurs qui se louaient collectivement pour des tâches déterminées, etc. Ce sont les grandes entreprises qui, pour assurer l'attraction d'une main-d'œuvre rare, puis la fixation d'une main-d'œuvre instable, ont mis en place des politiques d'attachement des travailleurs, souvent qualifiées de politiques paternalistes. Les salariés n'ont jamais revendiqué de telles politiques, mais, lorsqu'ils y ont été soumis, ils se sont organisés pour que leur application ne relève pas de la volonté unilatérale de l'employeur. Ceci s'est traduit par le développement de droits, de règles, de procédures en matière de licenciement. Le mouvement syndical a lutté pour la protection des travailleurs en cas de licenciement ; il n'a jamais fait de l'emploi à vie chez le même employeur un idéal, même s'il a tenu compte du fait que certaines catégories de travailleurs avaient trouvé dans ce modèle un sentiment de sécurité. Aujourd'hui, l'ampleur et la permanence des mouvements de restructuration, dans un contexte de chômage massif, posent de façon aiguë la question de la sécurité de l'emploi. Compte tenu des problèmes rencontrés dans l'identification de la figure de l'employeur, il n'est pas évident que la garantie de l'emploi soit le mieux assurée par le renforcement du lien qui, à travers le contrat de travail, unit chaque travailleur à un employeur particulier. La question se pose d'une socialisation des mécanismes qui assureraient une garantie d'emploi dans les restructurations. Une objection immédiate naît du risque qu'il y aurait ainsi à " déresponsabiliser l'entreprise " en lui permettant de reporter sur la collectivité les coûts de sa gestion de l'emploi. Mais la question n'est pas de libérer l'entreprise de toute obligation en matière d'emploi ; elle est de définir les obligations qui contribueraient le plus efficacement à une sécurité de l'emploi assurée à l'échelle sociale et pas seulement microéconomique. L'expérience historique, ainsi que des débats et expériences émergents, nous proposent trois axes de réflexion : l'application, sous la responsabilité de la collectivité, du principe du pollueur payeur (ou " internalisation des externalités ") ; l'aménagement de carrières professionnelles construites sur le développement des qualifications (et/ou des compétences) ; enfin, l'organisation des mobilités dans le cadre territorial. 21. La régulation par les incitations financières Deux rapports récents, celui d'Olivier Blanchard et Jean Tyrole et celui de Pierre Cahuc et François Kramarz , proposent une nouvelle conception de la responsabilité des entreprises en matière de licenciement. Leurs analyses ont un large socle commun, mais divergent quant à la base de calcul et au mode d'usage des incitations financières. Le point de départ est l'affirmation de la responsabilité de l'entreprise sur les effets externes négatifs de ses décisions de licenciement. Par analogie avec le principe du pollueur payeur, elle doit supporter la charge des coûts qu'elle engendre pour autrui, en particulier pour le salarié licencié et pour la collectivité. Pour les auteurs cités, des prélèvements financiers sur les entreprises, dès lors qu'ils seraient correctement calculés, constitueraient un instrument suffisant pour inciter celles-ci à adopter un comportement optimum. Ces prélèvements doivent se substituer à tout l'appareil réglementaire et jurisprudentiel qui entrave la liberté d'action de l'entreprise et, en particulier, à toute obligation de mise en œuvre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi. La notion de licenciement économique disparaît alors, ainsi que les procédures de contrôle de sa légitimité. L'entrepreneur est seul juge de l'opportunité d'un licenciement dès lors qu'il connaît et prend en charge le coût social total qui en résulte. Les deux rapports sont également d'accord sur la nécessaire unification des contrats de travail et, dans ce cadre, sur l'instauration d'une indemnité de licenciement qui soit fonction de l'ancienneté dans l'emploi. La divergence porte sur ce qui est dû par l'entreprise à la collectivité. Dans le rapport Blanchard-Tyrole, une agence indépendante verse une indemnisation aux chômeurs jusqu'à leur retour à l'emploi, sous réserve d'un contrôle de la recherche d'emploi. Pour financer ces prestations, elle prélève sur chaque entreprise une taxe déterminée par les coûts d'indemnisation qu'ont engendrés les licenciements opérés par cette entreprise. C'est le principe de bonus malus ou d'experience rating, largement appliqué en Amérique du Nord. Le rapport Cahuc-Kramarz rejette ce mode de calcul parce qu'il décourage l'embauche des travailleurs les plus fragiles ; en effet, ceux-ci seront les plus vulnérables aux licenciements et les plus longs à reclasser, donc générateurs de malus pour l'entreprise. La contribution de l'entreprise doit être proportionnelle à la rémunération totale perçue par le salarié depuis l'origine du contrat de travail, ce qui introduit une protection croissante avec l'ancienneté. Surtout, cette contribution n'est pas destinée à l'indemnisation du chômage. Elle est versée au Service public de l'emploi pour financer des opérations de reclassement qu'il confie, après appels d'offres, à des opérateurs spécialisés. Le rapport Cahuc-Kramarz opère donc une distinction essentielle entre d'une part, la responsabilité de l'entreprise en cas de licenciement, responsabilité qui est affirmée mais qui n'est traduite que par une contribution financière, et, d'autre part, la responsabilité du reclassement qui relève du Service public de l'emploi et non des entreprises. Soulignant la faible efficacité finale des Plans de sauvegarde de l'emploi, les auteurs écrivent : " La solidarité est défaillante parce qu'elle est limitée par les frontières de l'entreprise " (p.152). On mesure bien l'intérêt et les risques associés à l'adoption d'une telle problématique. L'intérêt est d'accorder la responsabilité de la mise en œuvre des opérations de reclassement au Service public de l'emploi dès lors qu'il y a rupture du contrat de travail. Disparaissent ainsi les inégalités de droit entre salariés liées à la nature de leur contrat de travail, à l'ampleur des licenciements, à la dimension de l'entreprise ou au rapport de forces qui s'y est établi dans le cas d'un Plan de sauvegarde de l'emploi. Le risque principal est d'exonérer l'entreprise de toute obligation de faire en échange d'une obligation de payer. L'hypothèse est que le bon calcul des contributions suffira pour que l'entreprise adopte un comportement optimal du point de vue de la collectivité. Par exemple, l'entreprise assurera des formations d'adaptation ou des reclassements internes si la solution est, pour elle, moins coûteuse qu'un licenciement. On trouve là l'expression d'une foi inébranlable dans la rationalité du calcul microéconomique des entreprises. L'expérience, par exemple celle des chèques valises, enseigne que la possibilité offerte aux entreprises de se libérer en monnaie de l'exercice de leurs obligations n'engendre pas toujours les comportements les plus souhaitables du point de vue de l'intérêt collectif. Le risque complémentaire est que la gestion des restructurations disparaisse du champ des rapports collectifs dans l'entreprise (consultation ou négociation). L'entreprise verse, pour solde de tout compte, à chaque salarié une indemnité de licenciement et au Service public de l'emploi (ou à l'agence d'indemnisation) une contribution par individu licencié. L'opération de restructuration se réduit à une addition de dossiers individuels . Il importe donc de poursuivre la réflexion sur le contenu possible des obligations de faire pour l'entreprise et sur les conditions de négociation de leur mise en œuvre. 22. La sécurisation des trajectoires professionnelles Les ouvriers de métier du XIX° siècle trouvaient la sécurité de l'emploi dans la maîtrise de qualifications reconnues et transférables, constamment entretenues et élargies par la diversité de leurs expériences professionnelles. Les syndicats de métier contrôlaient l'offre de ces savoir-faire spécialisés et organisaient la mobilité de leurs membres. Au XX° siècle, la notion de " marché du travail professionnel " a été introduite pour rendre compte de formes d'organisation qui reprenaient les mêmes principes avec des modalités institutionnelles différentes selon les pays. La question aujourd'hui n'est pas de ressusciter des modèles anciens, mais de s'interroger sur la pertinence de modes de gestion des restructurations qui reposeraient moins sur la défense du lien à l'employeur et plus sur des droits pour les salariés à l'acquisition et au développement de qualifications et de compétences reconnues et transférables. Avec les changements techniques et organisationnels intervenus au cours des dernières décennies, de nombreuses spécialités professionnelles sont apparues qui répondent partiellement à cette logique. Les travaux de Yannick Fondeur et de Catherine Sauviat sur les services informatiques aux entreprises montrent comment le passage par les SSII constitue pour de jeunes diplômés l'occasion d'enchaîner des apprentissages et des expériences professionnelles dans différentes entreprises clientes, préparant ainsi leur sortie vers d'autres types d'emploi (entreprises clientes ou start-up). Dans l'intervalle, ils négocient la qualité de leur travail et leur niveau de rémunération grâce à une menace de départ, crédibilisée par une riche information sur l'état du marché du travail (Fondeur, Sauviat, 2003). Il ne faut pas limiter cette observation aux domaines de mise en œuvre des technologies de l'informatique ; de multiples autres illustrations pourraient en être données, y compris dans des professions longtemps considérées comme " traditionnelles ", par exemple, les infirmières. Adopter une telle perspective engendre deux types de transformations portant d'une part, sur la nature des obligations relevant de la responsabilité de l'entreprise, d'autre part, sur les acteurs et les niveaux de régulation sociale pertinents. Les obligations de l'entreprise ne portent plus sur les formations d'adaptation de leurs salariés à l'évolution des emplois qu'ils occupent, ni sur leur reclassement interne. Elles portent sur l'offre d'apprentissages qualifiants, ce qui implique non seulement des actions de formation permettant le développement des compétences, mais aussi une organisation du travail qualifiante qui crée à la fois le désir et la capacité d'élargir ses qualifications. Pour garantir des trajectoires professionnelles, les actions requises de l'entreprise doivent déboucher sur des procédures de validation ou certification des qualifications ou des compétences qui en assurent la transférabilité, ce qui pose la question des modes de création des repères collectifs. L'obligation de faire de l'entreprise, s'il s'agit de sécuriser les trajectoires professionnelles, doit s'inscrire dans des repères collectifs qui cadrent la prospective de l'emploi et des métiers, définissent les référentiels de formation et les modes de certification reconnus. L'accord national interprofessionnel de 2003 sur la formation et la partie de la loi Fillon de 2004 qui le transcrit ont ouvert la voie à des avancées potentiellement importantes en reconnaissant le principe d'un droit individuel à la formation, qui ne se réduise pas à une réponse aux besoins de l'entreprise, et en prévoyant les conditions d'accès à des procédures de validation des acquis de l'expérience. Dans le même temps, l'accord a renforcé le contrôle exercé par les branches professionnelles au niveau national. Le fractionnement, sauf quelques exceptions majeures, et l'extrême hétérogénéité de ces branches font qu'on peut s'interroger sur la pertinence de ce niveau pour gérer l'évolution de compétences et de métiers qui ont, de plus en plus, un caractère transversal relativement aux branches professionnelles, telles qu'elles sont actuellement découpées. Quel que soit le jugement porté sur la pertinence et l'efficacité prévisible des nouveaux dispositifs créés par ces deux textes, un point intéressant, dans notre perspective, réside dans le fait qu'ils introduisent une nouvelle logique possible de gestion des restructurations industrielles, au caractère à la fois préventif et socialisé, sans éliminer la responsabilité de l'entreprise en ce domaine, mais en modifiant sa nature. 23. L'équilibre dynamique des territoires Plusieurs éléments de diagnostic doivent être pris simultanément en considération lorsqu'on analyse les évolutions du dernier quart de siècle. - Face à des restructurations qui engendrent des suppressions massives d'emploi, les capacités de mobilisation et les manifestations effectives de solidarité ont tendance à se concentrer à l'échelle des territoires. Pour l'illustrer de manière caricaturale, remarquons que si un groupe multinational ferme une unité de production, les salariés de celle-ci obtiendront plus facilement un soutien immédiat et actif des populations locales, dans leur hétérogénéité socioprofessionnelle, et des acteurs politiques et sociaux locaux, dans toute leur diversité, qu'ils ne l'obtiendront concrètement des autres salariés du groupe à l'échelle nationale et, a fortiori, mondiale - Sauf pour les cadres, les mobilités dans l'espace se limitent majoritairement à l'échelle des territoires, notamment du fait de la généralisation des ménages ayant au moins deux actifs et de la diffusion du chômage dans toutes les régions. " Vivre et travailler au pays " n'est pas un slogan passéiste, mais l'expression d'un besoin qui a pris une force croissante. - Les expériences novatrices de création d'activités et d'emplois, ou de soutien à la création de ces activités, requièrent de nouveaux compromis ou de nouvelles alliances qui, pour l'instant, ne semblent possibles qu'à l'échelle des territoires. - Certains grands groupes se sont reconnus, au-delà de la gestion de leurs salariés victimes de leurs décisions de restructuration, des responsabilités dans le maintien d'un équilibre dynamique du marché du travail pour les bassins d'emploi où ils exercent une influence dominante (Raveyre, 2001). Ils ont créé des outils spécifiques à cette fin et organisé des réseaux de coopération avec les acteurs locaux. La question est donc de déterminer dans quelle mesure le territoire peut devenir un niveau pertinent de régulation sociale des restructurations et, plus largement, un cadre spatial au sein duquel des dispositifs nouveaux pourraient contribuer à garantir une sécurité de l'emploi. Il s'agit d'un problème particulièrement difficile compte tenu des multiples difficultés soulevées . - Comment prendre en compte l'hétérogénéité des acteurs, la faiblesse de certains d'entre eux ou leurs réticences à s'engager à l'échelle du territoire ? - En l'absence de tradition historique, faut-il développer dans les territoires les modes classiques de la négociation collective ou imaginer des formes plus complexes et flexibles de " dialogue social territorial " ? - Comment, sous le choc des restructurations, éviter une ruineuse mise en concurrence des territoires pour l'attraction d'activités nouvelles ? - Comment définir la nature de la responsabilité des entreprises, et en particulier des groupes, à l'égard des territoires où ils sont implantés et comment la traduire en obligations de faire ? Le débat est difficile, mais il est ouvert. Une illustration significative en est la réaction intéressée des organisations syndicales à la proposition avancée par Jean-Louis Borloo de créer un contrat de travail intermédiaire. Sans connaître, au moment où nous écrivons , le contenu technique de ce projet, ni pouvoir en apprécier le degré de sérieux, soulignons qu'il prévoirait la création d' " agences locales de retour à l'emploi " qui, à l'échelle des bassins d'emploi (ou de certains d'entre eux seulement), maintiendraient un contrat de travail pour les victimes de restructurations et mutualiseraient les moyens entre les entreprises pour gérer les reconversions. Plusieurs précisions sont nécessaires, au terme de cette analyse, pour tenter d'éliminer quelques risques d'ambiguïté. - Il existe un clair contraste entre, d'une part, le contenu de la première partie, qui concerne des mécanismes codifiés, bien rodés, dont on peut évaluer objectivement les qualités et les faiblesses et, d'autre part, celui de la seconde partie où sont examinées des propositions, des innovations locales ou des dispositifs potentiellement mobilisables au service de logiques différentes, sans disposer des moyens d'une évaluation sérieuse. - La thèse défendue n'est pas que le premier modèle correspondrait à des modes de régulation anciens, aujourd'hui dépassés, et qu'il conviendrait d'abandonner pour le remplacer par des modèles alternatifs, seuls porteurs d'avenir. La thèse est qu'il n'y a aucune raison de privilégier a priori le premier modèle et de considérer les autres avec méfiance. Il faut comparer, en évolution, leurs avantages et leurs faiblesses respectifs, apprécier dans quelle mesure il est possible de les combiner et repérer, à l'opposé, les conditions dans lesquelles ils sont générateurs de contradictions pour l'action syndicale. - L'objectif n'est pas de décharger l'entreprise de la responsabilité des suppressions d'emplois qu'engendrent les restructurations. La question est de déterminer quels types d'obligations engendre pour l'entreprise sa responsabilité. L'analyse économique, même orthodoxe, admet la légitimité d'une imputation à l'entreprise des effets externes négatifs qu'elle produit. Il reste à préciser la nature des contraintes ou des coûts qui seront imposés à celle-ci (obligation de payer et/ou obligation de faire). Là se situent les différences entre les modèles envisagés. - Enfin, il faut définir les procédures par lesquelles ces contraintes et coûts sont imposés. Elles peuvent emprunter la voie de la réglementation ou celle de la négociation, sans ignorer que certaines entreprises, pour diverses raisons, peuvent s'engager par un " code de bonne conduite ". Le modèle de la " responsabilité sociale des entreprises ", souvent privilégié aujourd'hui, notamment par les instances européennes, n'apparaît recevable que s'il est complémentaire d'un système de normes collectivement déterminées. Références bibliographiques Aglietta Michel, Rébérioux Antoine (2004), Dérives du capitalisme financier, Paris, Albin Michel. Aubert Jean-Pierre, Beaujolin-Bellet Rachel (2004), " Les acteurs de l'entreprise face aux restructurations : une délicate mutation ", Travail et emploi, n°100, octobre. Beaujolin Rachel (1999), Les vertiges de l'emploi. L'entreprise face aux réductions d'effectifs, Paris, Grasset-Le Monde. Blanchard Olivier, Tirole Jean (2003), Protection de l'emploi et procédures de licenciement, Rapports du Conseil d'analyse économique, Paris, La documentation française. Blassel Hugues, Jacquier Jean-Paul (1997), " La représentation sociale territoriale ", La revue de l'IRES, n°25. Bruggeman Francis (2003), " Restructurations :pratiques françaises, dispositifs, regard de l'expert ", Regard, Les cahiers de Syndex. Cahuc Pierre, Kramarz Francis (2004), De la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale professionnelle, Rapport au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Paris. Commission européenne (1998), Gérer le changement, Rapport final du groupe d'experts de haut niveau sur les implications économiques et sociales des mutations industrielles, Luxembourg. Commission européenne (2002), La responsabilité sociale des entreprises, Luxembourg. Degryse Christophe, Pochet Philippe (2004), Bilan social de l'Union européenne 2003, Bruxelles, ISE-OSE-SALTSA. Duclos Laurent, Mériaux Olivier (2001), Agencements territoriaux et internalisation de la responsabilité de l'emploi, Programme TSER-DG XII " Local level concertation ". Fondeur Yannick, Sauviat Catherine (2003), " Les services informatiques aux entreprises : un marché de compétences ? ", Formation et emploi, n°82. Freyssinet Jacques (2000), " Les syndicats face aux restructurations ", in : Thierry Lemasle, Pierre-Eric Tixier (sous la direction de), Des restructurations et des hommes, Paris, Dunod. Freyssinet Jacques, Seifert Helmut (2000), Negociating Employment and Competitiveness, Luxembourg, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Huiban Jean-Pierre (1983), " Intervenir sur les politiques industrielles ", CFDT Aujourd'hui, mars-avril. Jobert Annette (2003), " Quelle régulation dans l'espace territorial ? " in : G. de Terssac (Ed.), La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud : débats et prolongements, Paris, La découverte. Jobert Annette (2004), " Le dialogue social territorial : entre logique de projection et logique de projet ", Commissariat général du plan, Notes Thomas, n°7, avril. Lojkine Jean (1996), Le tabou de la gestion. La culture syndicale entre contestation et proposition, Paris, Ed. de l'Atelier. Morin Marie-Laure (1999), " Espaces et enjeux de la négociation collective territoriale ", Droit social, juillet-août. Raveyre Marie (2001), " Implication territoriale des groupes et gestion du travail et de l'emploi. Vers des intermédiations en réseaux ", La revue de l'IRES, n°35. Saglio Jean (2004), " Le local n'est pas un " mini-macro ". La régulation locale des relations professionnelles, atouts et limites ", Commissariat général du plan, Notes Thomas, n°8, juin. Sauviat Catherine et Pernot Jean-Marie (2000), " Fonds de pension et épargne salariale aux Etats-Unis : les limites du pouvoir syndical ", L'année de la régulation, Paris, La Découverte. Sisson Keith, Martin Ardiles Antonio (2000), Handling Restructuring. Collective Agreements on Employment and Competitiveness, Luxembourg, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Thomas (groupe) (2004), " Négociation sociale et territoire : enjeux et perspectives ", Commissariat général du plan, Le quatre pages, n°3, décembre. Zarifian Philippe (1983), " La culture syndicale face à la nécessité de propositions industrielles : défis, mouvements, portée ", Critique de l'économie politique, avril-septembre. Résumé Il est légitime d'affirmer la responsabilité de l'entreprise sur les coûts sociaux qu'engendrent ses opérations de restructuration. Il n'est pas évident, pour autant, que l'entreprise constitue le bon niveau pour garantir les droits à l'emploi des salariés. L'indétermination de la définition de l'entreprise fait que l'action syndicale risque d'être écartelée entre le niveau de l'unité de production, pertinent pour la mobilisation des travailleurs, et le celui de la tête du groupe, pertinent pour l'intervention sur les choix économiques. D'autres acteurs et d'autres niveaux peuvent assurer une socialisation de la gestion des conséquences des restructurations sur l'emploi. On peut, par exemple, donner la maîtrise d'œuvre au service public de l'emploi, ou construire des dispositifs collectifs qui offrent une sécurité dans les trajectoires professionnelles, ou encore privilégier la coopération des acteurs à l'échelle des territoires. Ces solutions ne visent pas à " déresponsabiliser " l'entreprise, mais à définir en d'autres termes les obligations qui naissent pour elle de sa responsabilité. Ce texte a pour origine deux contributions présentées l'une, en octobre 2003, au séminaire " Restructurations " de l'IRES et l'autre, en novembre 2004, aux journées d'études " Décisions d'emploi et organisations productives. La subordination en question " organisées par le MATISSE (Université Paris I-CNRS). Même si la récente loi Borloo introduit des reculs sur ce point. Voir : Commission européenne, 1998 et 2002. Plus proche, mais encore insuffisant s'il s'agit de groupes mondiaux. Au niveau européen, la CES, l'UNICE et le CEEP se sont mis d'accord, le 16 octobre 2003, sur des " Orientations de référence pour gérer le changement et ses conséquences sociales ". Le texte, présenté par ses rédacteurs comme non contraignant et non susceptible de faire l'objet d'une Directive, n'a pas été soumis au vote du Comité exécutif de la CES qui s'est borné à en " prendre note ". Cette attitude s'explique probablement par le fait que le document se limite à un catalogue de déclarations d'intention (voir : Degryse, Pochet, 2004). C'est-à-dire unies par des liens volontaires, révocables, non réductibles à des prises de participations financières. Il y a, bien sûr, des exceptions dont il est important d'analyser la nature et les causes, mais qui ne peuvent être utilisées pour ignorer les tendances dominantes. Voir par exemple : Lojkine, 1996. Voir Huiban, 1983 et Zarifian, 1983. Toujours, comme nous l'avons dit plus haut, sans négliger les exceptions. Voir, par exemple : Sisson, Ardiles, 2000 ; Freyssinet, Seifert, 2001. Voir, en particulier dans le cas des fonds de pension aux Etats-Unis : Sauviat, Pernot, 2000. Pour le Conseil d'analyse économique : Blanchard, Tyrole, 2003. Pour le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le Ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité : Cahuc, Kramarz, 2004. Il subsiste cependant un contrôle judiciaire de la qualification du licenciement, par exemple pour faute, ou d'éventuelles pratiques discriminatoires. Le développement des formes d'emploi temporaire (CDD, intérim…) a eu pour but principal de contourner la réglementation des licenciements économiques. Il engendre une dualisation du marché génératrice d'inefficacité et d'inégalité. Le rapport Blanchard-Tyrole propose un contrat de travail unifié sans en préciser la nature, tandis que le rapport Cahuc-Kramarz retient explicitement le CDI comme forme unique. Tout au plus peut-on espérer, comme le font Cahuc et Kramarz, que la volonté d'éviter les coûts de licenciement conduise l'entreprise à négocier préventivement d'autres solutions qui permettent d'y échapper. Nous n'entrerons pas ici dans le débat portant sur les rapports entre les notions de qualification et de compétence. Une réflexion de synthèse et des perspectives nouvelles ont été produites par les travaux du groupe Thomas au sein du Commissariat général du plan. Nous les utilisons largement. Voir : Jobert, 2004 ; Saglio, 2004 ; Thomas, 2004. C'est-à-dire non limitées à un dédommagement financier en cas de suppression d'emplois. Janvier 2005. Jacques Freyssinet
Professeur émérite (Université Paris 1);Président du Conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi;Membre du Comité editorial d'Insight |